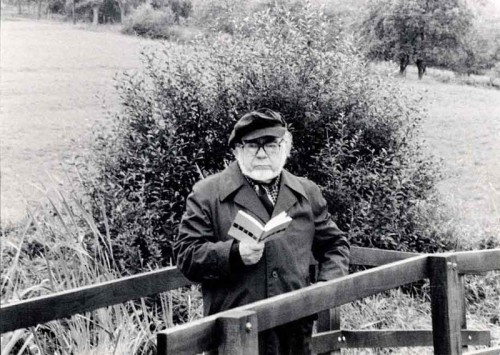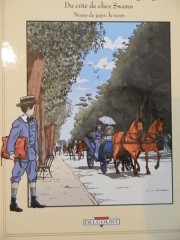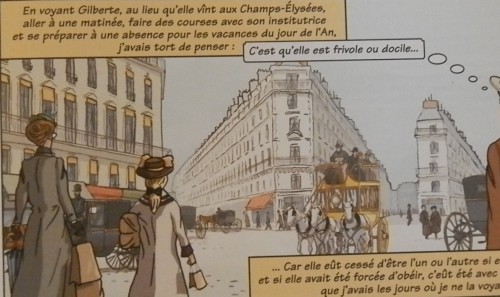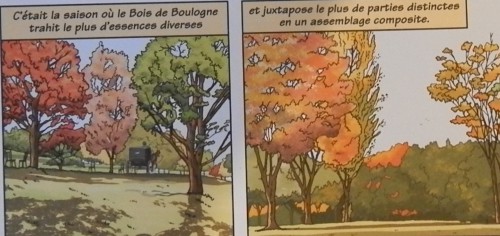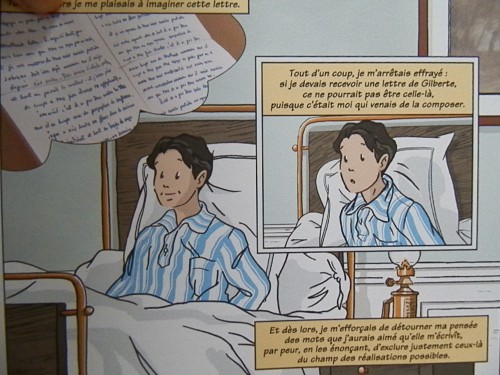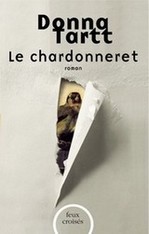 Je vous présente la cause de ma longue absence de ce blog : elle s'intitule le chardonneret qui avant d'être un roman est un tableau et avant d'être un tableau un oiseau (dont j'ignorais l'existence). Passons sur l'oiseau, arrêtons-nous sur le tableau. Exposé dans un musée de New-York, il représente comme son nom l'indique un chardonneret qui se tient sur un perchoir auquel il est relié par une chaîne. Il fait 33*22cm. Assez petit donc et une des raisons pour laquelle la romancière Donna tartt (dont j'avais lu il y a 20 ans le fameux maître des illusions) l'a choisi comme fil rouge de son dernier roman dont je suis venu ici vous dire ma première et dernière impression.
Je vous présente la cause de ma longue absence de ce blog : elle s'intitule le chardonneret qui avant d'être un roman est un tableau et avant d'être un tableau un oiseau (dont j'ignorais l'existence). Passons sur l'oiseau, arrêtons-nous sur le tableau. Exposé dans un musée de New-York, il représente comme son nom l'indique un chardonneret qui se tient sur un perchoir auquel il est relié par une chaîne. Il fait 33*22cm. Assez petit donc et une des raisons pour laquelle la romancière Donna tartt (dont j'avais lu il y a 20 ans le fameux maître des illusions) l'a choisi comme fil rouge de son dernier roman dont je suis venu ici vous dire ma première et dernière impression.
Soit donc, un ado qui s'appelle Théodore et qui erre dans un musée de New-York (le Met) avec sa mère (dans les années 90?). Soit une bombe qui explose et la mère qui décède. Théo est allongé et choqué . Près de lui, un vieux monsieur mal en point se meurt mais a le temps de lui donner sa bague et de lui demander de chiper le tableau qu'il lui montre du doigt. Théo parvient à s'extirper du musée sans que personne ne le voit (totalement improbable mais bon). Théo se retrouve chez lui, est inconsolable et en possession d'un tableau de grande valeur. Il est très vite pris en charge par les services sociaux. Commence alors une drôle de vie lors de laquelle il va vivre dans une maison bourgeoise de Manhattan, à Las Vegas avec son père alcoolique puis de retour à New-York chez un antiquaire (associé du vieux monsieur qui lui confia la bague) chez qui il finit par travailler. Parallèlement, Théo devient accro à toutes sortes de drogues, faussaire, et point essentiel fait la connaissance de Boris, un américain d'origine ukrainienne avec qui il fait les pires conneries. Pendant ce temps, Théo conserve méticuleusement son tableau (caché dans une taie d'oreiller) sauf vers la fin où le roman jusque-là plutôt lent dans le déroulé s'accélère et se transforme en polar avec une effroyable scène de crime sur un parking d'Amsterdam.
Les critiques sont unanimes, le dernier Donna n'est pas de la Tartt. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis plus circonspect. Passons sur les invraisemblances, on a vu pire, mais que de longueurs inutiles (Donna s'est donné le temps, elle a commencé son écriture à la fin du XXème siècle). 800 pages, j'en connais quelques-uns que ça va rebuter (une personne à qui je l'ai offert entre autres). Sur le fond (et là, ce n'est pas une critique) je n'ai pas compris les motivations de Théo. Pourquoi garde-t-il ce tableau qu'il ne peut vendre et qu'il ne regarde qu'à peine ? Mais c'est son comportement général qui m'a agacé. Altruiste et déphasé, Théo avance et agit sans se soucier des lendemains. Vers la fin, il tente de donner un sens métaphysique à sa vie rocambolesque mais c'est peu pertinent et surtout un peu trop gros sabots. Encore une chose, je tenais à avertir ceux qui vont s'y atteler : toute la partie polar (depuis le moment où Théo retrouve Boris à NY jusque Amsterdam est incompréhensible ; un conseil : lire cette partie sans chercher à la comprendre).
Pour le reste, bien sûr tout n'est pas à jeter dans ce roman : la description de l'intérieur du NY des années 2000, le milieu des antiquaires (ce qu'on se sent bien dans la boutique de Hobbie où travaille Théo), la description du désert aux portes de Las Vegas et puis évidemment le miracle de la drogue (car Théo est un vrai junkie), le bonheur qu'elle procure et le manque qu'elle cause.
En fin de compte, des images restent mais honte à moi, au moment où j'écris cette note, je ne sais même plus ce qu'il advint de la toile. Le chardonneret s'est-il défait de sa chaîne et du tableau pour s'envoler par delà le soleil, par delà les éthers, par delà les confins des sphères étoilées ?
Lecture : janvier/février 2014, kindle, 3/5.

 Le quotidien Ouest-France fait un peu partie de ma famille. Mon père était abonné et j’ai appris beaucoup de choses en le lisant (économie, bourse, problèmes internationaux, la position des navire dans la rubrique 'où sont nos navires?'). Ce que j’aime dans ce quotidien, c’est sa mesure (on le dit de centre-droit) et son humanisme. Quand j’étais petit, je ne lisais pas l’édito de la première page qui me semblait rébarbatif. Aujourd’hui, je le lis systématiquement (écrits par
Le quotidien Ouest-France fait un peu partie de ma famille. Mon père était abonné et j’ai appris beaucoup de choses en le lisant (économie, bourse, problèmes internationaux, la position des navire dans la rubrique 'où sont nos navires?'). Ce que j’aime dans ce quotidien, c’est sa mesure (on le dit de centre-droit) et son humanisme. Quand j’étais petit, je ne lisais pas l’édito de la première page qui me semblait rébarbatif. Aujourd’hui, je le lis systématiquement (écrits par 
 Ce n'est pas utile de faire des manières pour dire des choses simples : les croix de bois évoquent, à travers les souvenirs du narrateur, Jacques (le double de l'auteur), le quotidien dans les tranchées lors de la guerre 14-18. Le récit se compose de 17 chapitres indépendants qui sont chacun comme des tableaux représentant divers moments de la vie des soldats : l'arrière-front, le combat proprement dit, les relèves, l'attente dans les bourgs parmi les villageois. On fait la connaissance de Sulphart, de Gilbert, de Bouffioux (le ch'ti) et autres soldats aux caractères divers évidemment. Jacques, le narrateur, on se demande s'il n'est pas transparent tant il est peu mis à contribution, on ne lui adresse quasiment pas la parole, on dirait qu'il n'est là que pour écrire le livre.
Ce n'est pas utile de faire des manières pour dire des choses simples : les croix de bois évoquent, à travers les souvenirs du narrateur, Jacques (le double de l'auteur), le quotidien dans les tranchées lors de la guerre 14-18. Le récit se compose de 17 chapitres indépendants qui sont chacun comme des tableaux représentant divers moments de la vie des soldats : l'arrière-front, le combat proprement dit, les relèves, l'attente dans les bourgs parmi les villageois. On fait la connaissance de Sulphart, de Gilbert, de Bouffioux (le ch'ti) et autres soldats aux caractères divers évidemment. Jacques, le narrateur, on se demande s'il n'est pas transparent tant il est peu mis à contribution, on ne lui adresse quasiment pas la parole, on dirait qu'il n'est là que pour écrire le livre.