 résumé : Une colline: superbe, couverte de maisons de luxe. Un drame: Lisa est retrouvée noyée dans le lac après une soirée pas très claire. Evy, son frère, quatorze ans, mutique et énigmatique, pourrait bien être responsable. N'importe où ailleurs, les choses seraient vite réglées. Sur la colline, royaume de l'apparence, les façades cachent d'invraisemblables malentendus... Après un détour par la forme brève qui avait abouti au superbe Frictions, Philippe Djian revient au roman avec une force nouvelle, une précision et une invention plus personnelles que jamais.
résumé : Une colline: superbe, couverte de maisons de luxe. Un drame: Lisa est retrouvée noyée dans le lac après une soirée pas très claire. Evy, son frère, quatorze ans, mutique et énigmatique, pourrait bien être responsable. N'importe où ailleurs, les choses seraient vite réglées. Sur la colline, royaume de l'apparence, les façades cachent d'invraisemblables malentendus... Après un détour par la forme brève qui avait abouti au superbe Frictions, Philippe Djian revient au roman avec une force nouvelle, une précision et une invention plus personnelles que jamais.
Philippe Djian, c'est toujours un peu la même chose et c'est sans doute pour ça qu'on l'aime : dans un pays imaginaire mais qui fait plutôt penser auxStates, une histoire familiale abracadabrante avec des personnages cinglés, shootés aux anxyolytiques et à la sexualité libérée, des jeunes qui ne respectent rien et en tout cas pas leurs parents, des réceptions qui se finissent lamentablement, des bitures monumentales, des accidents domestiques, des suicides ou des meurtres toutes les cinquante pages. Des catastrophes climatiques et j'en passe et des meilleurs. Tout ça n'est pas crédible mais c'est divertissant à souhait. L'écrivain fait en sorte que le lecteur ne s'ennuie jamais. Le style est concis, fluide, direct et colle à l'action.
On adhère ou on n'adhère pas. Perso, j'adhère.
Et au même titre que Kundera, Zola ou Echenoz, Djian fait partie des écrivains dont j'ai envie de tout lire.
Ce roman en particulier est vraiment très réussi et son héros Evy Trendel, très attachant.
Je mets 4.75/5, ce que je n'ai jamais mis pour la crise de fou rire, cette nuit, à 2 heures du matin.
lecture du 19 au 24.05.09
Roman. Paru en 02/2005
note : 4.75/5
à venir : Moïra, Julien Green.
roman - Page 17
-
CR93 - impuretés - Philippe Djian
-
CR92 - treize mille jours moins un - Didier da Silva
 présentation de l'éditeur : Sam vit à Marseille mais surtout avec son piano et son chat, Francisco Goya, dit Judas. Des sons subtils qu’il tire de son piano et de la présence douce et têtue de son chat. Sam raffolait des gnocchis jusqu’au jour où il ne les a plus supportés. Sam regarde le ciel comme un espace vide. Sam aime la pluie. Sam entretient des rapports ambivalents avec Marseille. Sam se sent éternellement touriste. Sam parle peu. Sam tousse quand il fume. Sam est douillet. Sam a peur de l’eau. Sam fait des cauchemars. Sam fréquente les lavomatics. Sam ne sait pas quoi faire de son poisson mort. Francisco Goya dit Judas, le chat, est intrépide. Ou maladroit. En tout cas, il tombe de la fenêtre pendant que la pédale du piano se casse.
présentation de l'éditeur : Sam vit à Marseille mais surtout avec son piano et son chat, Francisco Goya, dit Judas. Des sons subtils qu’il tire de son piano et de la présence douce et têtue de son chat. Sam raffolait des gnocchis jusqu’au jour où il ne les a plus supportés. Sam regarde le ciel comme un espace vide. Sam aime la pluie. Sam entretient des rapports ambivalents avec Marseille. Sam se sent éternellement touriste. Sam parle peu. Sam tousse quand il fume. Sam est douillet. Sam a peur de l’eau. Sam fait des cauchemars. Sam fréquente les lavomatics. Sam ne sait pas quoi faire de son poisson mort. Francisco Goya dit Judas, le chat, est intrépide. Ou maladroit. En tout cas, il tombe de la fenêtre pendant que la pédale du piano se casse.Voici la vie de Sam, racontée dans ce roman de l’infime dont la musique est l’un des personnages. D’une écriture sensible, Didier da Silva construit un anti-héros attachant et vaguement agaçant, comme peuvent agacer les miroirs. Un personnage qui habite sa vie d’une drôle de manière, toute en distance et en observations. On suit ses déambulations urbaines et ses défaites, narrées avec humour. On devient le voyeur satisfait de la douce cruauté de la vie quotidienne. Sam a peur de son ombre et nous, peur qu’il ne disparaisse une fois le livre refermé, tellement on s’habitue à sa présence, comme s’il avait toujours existé en voisin discret. Mais c’est le destin des personnages.
mon avis : petit bouquin sympa qui se lit tranquillement et qui fait découvrir, à travers le regard un peu blasé mais très lucide de Sam, un autre Marseille, un Marseille secret, un Marseille des petites et un Marseille sous la pluie aussi, puisqu'il faut arrêter avec les clichés, il pleut de temps en temps à Marseille.
87 pages, c'est court mais suffisant pour reconnaître à Didier Da Silva, un certain talent pour dire l'indicible, le néant dans lequel nos quotidiens sombrent parfois.
et page 73, le narrateur se demande : Son profond désintérêt pour la marche de la société était-il le signe de sa sagesse ou d'un manque de vigueur intellectuelle ?
Dommage qu'on n'ait pas la réponse car j'aurais aimé l'avoir. Est-ce l'écrivain qui s'interroge à travers Sam.
Et en quoi, peut-on se désintéresser de la marche de la société par sagesse ? Car cela sous-entend que plus on est sage (au sens philosophique du terme évidemment), plus on se désintéresse du monde ? Or on aurait tendance à penser le contraire.
Cette question m'interpelle parce qu'à titre perso, je me fous de plus en plus ce qui se passe dans mon pays et dans le monde. Et pourquoi ? J'ai un début de réponse. C'est que ma vie personnelle me prend tellement de temps que je n'arrive plus à m'intéresser à ce qu'il y a en dehors de mon monde. Alors qu'ado et dans ma vingtaine d'années, c'était différent. J'avais tout mon temps pour essayer de comprendre et d'analyser ce que je voyais autour de moi puisque ma vie personnelle ne concernait que l'entretien de ma petite personne. C'est juste un début de réponse, qui m'éloigne du sujet mais qu'il me tenait à coeur de préciser.
éditions Léo Sheer, 89 pages
parution :5/11/08
lecture du 17 au 19 mai 2009
note : 3.5/5
à venir : impuretés, Philippe Djian (?) -
CR91 - passion fixe - Philippe Sollers
 résumé (par l'auteur lui-même p372 du roman)
résumé (par l'auteur lui-même p372 du roman)
Un lecteur, ou une lectrice, ouvre ce livre, le feuillette, le fait traduire, comprend vaguement que l'auteur a dû faire partie d'un complot subversif difficile à identifier. Les événements dont il est question sont lointains, on n'en garde qu'un souvenir contradictoire, la plupart des historiens les classent parmi les révoltes sans lendemain. Le narrateur commence par avoir envie de se suicider, ne le fait pas, rencontre une femme qui transforme son existence. Dora est une jeune et jolie veuve, avocate, dont le mari, disparu prématurément, possédait une vaste bibliothèque. Des livres anciens, des manuscrits rares, l'ouvre d'un collectionneur. [..] Il y a aussi une pianiste célèbre, Clara, une personnage mystérieux, François, ce dernier étant peut-être un espion chinois.
Le ton général est très critique sur la société du temps de l'auteur, mais la société, au fond, à quelques transformations techniques près, est toujours la même. Les références chinoises abondent, ce qui est plutôt curieux pour un auteur occidental de cette période. Que veut-il Que cherche-t-il ? Le narrateur semble mener une vie clandestine organisée très libre, notamment sur le plan amoureux. Comme il pense à des tas de choses à la fois, son récit donne souvent l'impression d'une un tableau cubiste. Parfois on est perdu, mais on s'y retrouve toujours.
mon avis : L'oeuvre de Sollers me laisse l'impression d'un immense gâchis, car je trouve qu'il y a du génie chez cet écrivain de la suite et de la cohérence dans les idées et puis que le tout est écrit avec une verve éclatante mais que hélas, on est très vite agacé par une tendance qu'il a à se la péter, à se mettre en avant, à tout le temps à ramener la couverture à lui.
En ce qui concerne ce roman en particulier, je trouve que pour un type qui soi disant critique la société dans laquelle il vit (au point de souhaiter plus ou moins la révolution), il profite plus que bien de cette société, volant de capitales en capitales, couchant (dans tous les sens du terme) d'hôtels en hôtels etc. Son analyse de la société est plus que sommaire et ils se contente de caricaturer le capitalisme en la personnifiant sous les membres de la famille Leymarcher-Financier.
Et Dora, la "passion fixe" du narrateur (qu'on devine être Sollers, hein, ça se sent que la narrateur et l'écrivain ne font qu'un) est trop parfaite pour être vraie (mais chez Sollers, les femmes sont toujours comme ça, intelligentes, super canons, raffinées, super baiseuses et tout).
Et le tout est truffé de références à la culture chinoise, et comme personnellement je ne connais rien à la Chine, ça ne m'a pas aidé.
Sentiment mitigé donc entre un style flamboyant et un nombrilisme trop affirmé. Mais l'agacement l'emporte.
lecture du 01.05 au 08.05.09
folio, 399 pages
note : 2.5/5
à venir : Mytal, Ayerdhal -
CR89 - Rouge fort - Nicolas Rithi Dion
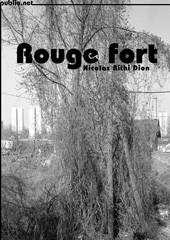
présentation de l'éditeur : Y a-t-il un lieu où la ville cesse, à partir duquel il n’y a plus la ville ?
Et dans le développement de nos mégapoles, en quoi d’explorer cette transition nous renseigne sur la ville elle-même, son territoire, ses usages, ses craquelures, ses signes ?
C’est ce qu’a entrepris Nicolas Rithi Dion. Si, quand il était étudiant aux Beaux-Arts Paris, la photographie était son outil principal, ce qu’il y a à photographier ici ne peut se dispenser du journal d’enquête, du récit des micro-voyages, au bord de l’autoroute A3, entre Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Sec. Puisque, au passage, c’est aussi l’idée de banlieue qu’on volatilise, obsolète.
Mais ce travail d’écriture devient autonome, cherche les signes, s’ouvre aux récurrences, aux fragmentations.
Ainsi, chaque nouvelle page du récit s’ouvre par le thème du motif, façade, parking, plan, déplacement, détail.
Et c’est une forme d’écriture neuve qui paraît, que je suis fier d’accueillir. Un travail sur la résolution, sur le champ, sur le cadre. La question du voir, et celle de l’expérience de soi-même comme sujet, pour débusquer le signe, le voir et le temps.
C’est cette relation, la photographie dans et par l’écriture, pour la réouvrir – en ce lieu, en ces signes, en ce temps – à la plus vieille tragédie du monde, et que la phrase, si la langue comme expérience c’est la poésie, puisse se charger de là où ce que nous avons fait du monde nous déborde.
Rouge fort est accompagné d’un cahier de douze photographies, que Nicolas Rithi Dion a souhaité insérer après le texte, et non pas de façon intercalée.
Un deuxième volet va suivre, Aller. C’est un champ neuf qui s’ouvre ici.mon avis : Encore un livre sur la géographie des banlieues...il faut dire que j'ai un faible pour ce genre de bouquins (voire un petit soucis m'ont dit certains) où il est question de zones périphériques, de lieux résiduels etc. La dernière lecture en date fut les passagers du Roissy Express de François Maspero, une sorte de road-movie du côté de la banlieue Nord de Paris, et puis il y a eu aussi le fameux livre blanc de Philippe Vasset dans lequel l'écrivain s'attachait à décrire les zones restées en blanc sur les cartes ign, ou encore zones de Jean Rolin (dont étrangement, je n'ai plus aucun souvenir).
Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec cet essai de Nicolas Rithi Dion. Le style est très contemporain (et qui ressemble un peu à de l'écriture automatique -on devine l'écrivain en train de griffonner ce qu'il voit sur des bouts de papier et puis ne pas retoucher) et ça m'a fait l'effet d'un long poème en prose, riche en vocabulaire, avec en personnage principal la zone (quelque part aux alentours de Noisy Le Sec, de l'A3, d'une impasse des Guillaumes) et ses dépendances : des décharges sauvages, des bagnoles abandonnées et dépecées, des ouvrages pas terminées et si on lève la tête, des fils à haute tension et puis le grondement de l'autoroute au lointain et encore plus loin peut-être quelque chose qui commence à ressembler à de la campagne.
Sinon, que signifie Rouge fort ? J'avoue là, je ne sais pas. Peut-être une antiphrase en fait, pour dire, pas rouge fort du tout...mais gris très pale. Peut-être. page 95, on lit "rouge fort, vermillon de géraniums". Avec ça -))
Pour terminer douze photos qui rappellent des scènes décrites dans le livre
Mais ça manque de bambous dans ces coins-là -)))extrait 1 (page25)(avec la photo qui va avec):

l'autre jour, deux paysagistes, plus ou moins sur une butte ou motte de terre, en discussion, allongeant le regard qui seul arpente, infatigable, léger, feuilles (plans) en mains, comme cartes pour se diriger, diriger l'oeil, aidé du doigt, parfois. alors seuls ils contemplent, seuls ils imaginent, enfin analysent selon des schémas plus ou moins en tête (c'est un binôme), vues répertoriées, débattues, projetées selon un certain idéal selon une certaine vie pratique selon une certaine conception, de base, longuement débattue, mais à cela on n'y revient pas, comme un refus, une perte de temps, à reformuler l'acquis, le tout, le démontré, le débattu, le prouvé, seulement l'espace, déjà configuré, ne pas y revenir.
extrait 2 (page35) :
toute l'après-midi la vaste zone, sorte de cuvette de fourmilion où se construit la nouvelle route cernée d'habitations, que ce soient des tours ou des pavillons étagés chacun ayant pignon sur rue, sa part du paysage que contourne un bras d'autoroute, sans oublier le cimetière ainsi que le chemin menant au coin des caravanes sans roue. incursion dans ce grand débarras (une voiture échouée, en terre, près du bitume encore frais, neuf, sans ces brûlures de pneus dérapant), encore qu'il soit davantage question d'une aire, lande, terrain à broussailles grimpantes, quelques potagers et arbres, surtout des plantes vivaces, rudérales et autres brousses, quand le pied ne foule pas de la terre désolée, asséchée ou simplement pas remuée, une croûte formée d'anciennes traces de tracteurs ou gros camions, de sorte que sont relégués à la lisière, tout autour de cet espace, comme une dernière écume au vent devenant mousse putride, ces amas de ferrailles, détritus, produits ménagers et tout ce qui peut passer allant du radiateur au frigo, de la conserve au canapé, ou du rideau à la chemise trouée. derrière une dune, petite élévation tout en long, repéré tout un chemin servant de dépotoir (c'est ici la fin de vie pour quelques voitures), ou juste dépôt puisque ça tourne, que la voiture brûlera bientôt, que d'autres carcasses viendront, certaines parties disparaissantes, désossées, réutilisées dans cette longue chaîne de la casse.
lecture du 25.04.09 au 27.04.09, note : 4/5, on trouve Rouge Fort ici.
-
CR86 - le désert des Tartares - Dino Buzzati
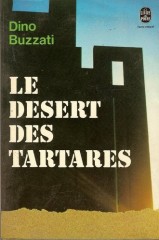 le mot de l'éditeur : Heureux d'échapper à la monotonie de son Académie militaire, le lieutenant Drogo apprend avec joie son affectation au fort Bastiani, une citadelle sombre et silencieuse, gardienne inutile d'une frontière morte. Au-delà de ses murailles, s'étend un désert de pierres et de terres desséchées, le désert des Tartares.
le mot de l'éditeur : Heureux d'échapper à la monotonie de son Académie militaire, le lieutenant Drogo apprend avec joie son affectation au fort Bastiani, une citadelle sombre et silencieuse, gardienne inutile d'une frontière morte. Au-delà de ses murailles, s'étend un désert de pierres et de terres desséchées, le désert des Tartares.A quoi sert donc cette garnison immobile aux aguets d'un ennemi qui ne se montre jamais ? Les Tartares attaqueront-ils un jour ?
Drogo s'installe alors dans une attente indéfinie, triste et oppressante. Mais rien ne se passe, l'espérance faiblit, l'horizon reste vide.
Au fil des jours, qui tous se ressemblent, Drogo entrevoit peu à peu la terrible vérité de fort Bastiani.
mon avis : Le désert des Tartares est un peu le roman du temps qui passe et surtout de l'attente, l'attente interminable, l'attente érigée en mode de vie mais je l'ai trouvé inférieur au rivage des Syrtes dont on le compare souvent (ce dernier lui étant postérieur) et ce pour deux raisons :
un, le style du Gracq est plus limpide et on y atteint des sommets littéraires, alors qu'avec le désert des tartares, on est en face d'une écriture plus blanche, avec en plus quelques lourdeurs de style dûs sans doute à la traduction (là je fais mon difficile mais bon c'est mon blog) avec par exemple des phrases de ce type :
les illusions jadis si faciles et si souhaitées, on les repoussait maintenant avec rage. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand chose, certes mais ce genre de phrases lourdes revient assez souvent. Et donc cette phrase aurait bien plus belle ainsi : on repoussait maintenant avec rage les illusions si faciles et si souhaitées.
deux, sur le fond, j'ai été un peu déçu par le dénouement, à savoir que le fort Bastiani est effectivement attaqué, bien que le récit se termine avant l'attaque proprement dîte. Mon avis est que Dino Buzatti aurait dû aller au bout de sa logique, à savoir faire perdurer l'attente jusque la dernière ligne et faire en sorte que pour le lecteur toute attaque ennemie reste jusqu'au bout une hypothèse totalement fantasque.
Mais la force du roman est que malgré le fait qu'il ne s'y passe rien, on ne peut pas y décrocher et ce n'est pas tant dû à l'hypothétique attaque des tartares (dont on ne croit pas) qu'à la description des fantasmes et élucubrations dont sont victimes les soldats voulant oublier la vacuité de leurs fonctions. J'ai réussi à rire quelques fois aussi devant le degré de maniaqueries de certains officiers obsédés par le règlement (Tronk et son obsession des mots de passe) et ça m'a rappelé mon passage sous les drapeaux à Compiègne lorsqu'en pleine nuit, je devais surveiller avec mon casque et mon famas, une réserve de munition dont la rumeur disait qu'elle était vide, et que par ailleurs, même si elle ne l'était pas, le régiment était déjà surveillé de toutes parts par d'autres soldats (dont la surveillance était de toute façon aussi vaine que la mienne). Et je me souviens que je trouvais toute cette mise en scène purement grotesque et que même, tout seul dans le froid, dans la nuit ou sous la pluie, il m'arrivait d'en rire. Je m'égare mais pas tant que ça.
Le désert des Tartares est un grand classique de la littérature mondiale, en ceci que son thème a une porté universelle : nous sommes tous concernés par la fuite du temps, tous plus ou moins ligotés par une bureaucratie implacable et tous nous espérons que le meilleur reste à venir (le meilleur pour les officiers du fort Bastiani étant la guerre...).
année : 1940
lecture du 11/04 au 12/04
note : 4/5
à venir : chroniques de San Francisco, tome 1, Armistead Maupin -
CR84 - les gens d'en face - Georges Simenon
 note de l'éditeur : aucune (mais résumé ici )
note de l'éditeur : aucune (mais résumé ici )mon avis : Après la route des flandres, que je conseille à tout le monde (non pas vraiment à tout le monde mais au moins à toi cher lecteur, - hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère - car si tu es ici c'est que tu n'es pas indifférent à la littérature) car c'est vraiment une expérience à faire, une expérience douloureuse peut-être mais dont on sort grandi (et fier aussi), un petit Simenon s'est imposé à moi car il traînait dans ma pal depuis quelques temps (depuis quelques années même) et puis quelque part, Simenon, dans le style, c'est quasiment de l'anti-Simon : pas de phrases interminables, tout est sobrement et efficacement présenté, on sait où on va, avec qui et quand (-)
Avec les gens d'en face, GS nous emmène en URSS dans les années 30, dans la ville de Batoum (dont le plafond bas et les rues désertes en font un cadre simenonesque idéal) située au bord de la mer Noire. Le principal protagoniste s'appelle Adil Bey et vient d'être nommé au consulat turc en remplacement du précédent mystérieusement mort. Très vite, Adil Bey s'ennuie dans cette ville où les gens meurent de faim, où la police communiste se débarrasse des récalcitrants, où tout le monde se fout de tout et il se rend compte très vite qu'on cherche à l'empoisonner.
Comme souvent avec Simenon, l'atmosphère est étouffante, les protagonistes, d'une banalité affligeante et l'air de rien, parallèlement au récit mené tambour battant et sans fioriture, Simenon nous décrit avec justesse le désœuvrement de la population russe et les excès de la bureaucratie.
Un petit polar sympa. Une parenthèse en quelque sorte (avant un Leiris dont j'attends beaucoup).lecture du 08.04 au 09.04
note : 4/5
à venir : l'âge d'homme, Michel Leiris -
CR83 : la route des Flandres - Claude Simon
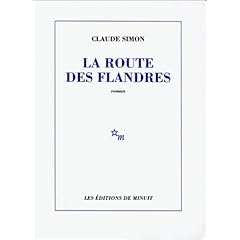 note de l'éditeur : Le capitaine de reixach, abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? un de ses cousins, Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité.
note de l'éditeur : Le capitaine de reixach, abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? un de ses cousins, Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité.
Aidé de blum, prisonnier dans le même camp, il interroge leur compagnon Iglésia qui fut jadis jockey de l'écurie Reixach. après la guerre, il finit par retrouver Corinne, la jeune veuve du capitaine...
mon avis : La Route des Flandres est sans doute le roman le plus difficile qu'il m'ait été donné de lire. Je cherche dans mes souvenirs de lecteur et je ne vois aucun autre où j'ai peiné à ce point. Deux raisons essentielles à cela :
un : le style très heurté, avec peu de ponctuation et une utilisation pléthorique du participe présent et surtout l'impression que les mots s'entrechoquent, se heurtent, s'anéantissent plutôt que de se suivre harmonieusement.
deux : la conduite du récit. pas vraiment de plan structuré mais une succession d'images désordonnées comme sorties d'un rêve absurde, d'un cauchemar plutôt parce qu'il s'agit (à ce que j'ai cru comprendre) de l'histoire de 3 soldats errant après la débâcle de 1940. Alors, à force d'inattention, j'ai failli plusieurs fois perdre le fil et d'ailleurs je l'ai perdu des pages entières avant de me ressaisir à la faveur de passages un peu plus explicites, mais le soucis c'est que l'auteur semble prendre un malin plaisir à dérouter le lecteur en brouillant les cartes et par exemple en passant d'une scène à l'autre dans la même phrase, voire même d'un narrateur à l'autre (le je de la fin d'une phrase n'est pas forcément le même je qu'au début..). Alors est-ce que j'ai aimé ou pas ce roman. La réponse est plutôt oui. Je pense que ça vaut la peine de le lire, qu'il faut prendre ça comme un challenge et puis accepter de ne pas tout saisir, de mettre l'intrigue au second plan pour se laisser emporter par l'écriture, qui est, comme je l'ai lu je ne sais plus où, le personnage principal de ce roman. Et quelques passages sont à ce point sublimes qu'ils valent à eux seul l'ingurgitation des 300 pages.
J'ai choisi 3 extraits . Avec, pour commencer, la description p234 (collection "double" éditions de minuit) du système d'ouverture d'un poulailler. savoureux....puis, plus à gauche, jaillissant juste de l'arête du dièdre comme d'une fissure entre la terre et le mur, il y avait une de ces plantes sauvages : une touffe, ou plutôt une corolle de feuilles réparties en couronne (comme un jet d'eau retombant), déchiquetées, dentelées et hérissées (comme ces anciennes armes ou harpons), vert foncé, râpeuses, puis, après cela, encore la tige - celle-ci légèrement inclinée vers la droite - d'une de ces mêmes hautes plantes, puis fixé au mur par un (sans doute y en avait-il encore un autre plus haut, mais il ne pouvait pas non plus le voir) tenon de fer, le montant ou plutôt le chevron de bois sur lequel était articulée une porte de poulailler : le tenon complètement rouillé, scellé dans le mur de briques, le ciment autour de l'épaisse lame de fer formant une collerette crémeuse dans laquelle on pouvait encore voir les traces de la truelle qui en lissant le mortier y avait laissé des empreintes dessinées par une bavure (léger bourgeonnement grumeleux de la matière pressée) en relief, le chevron - le montant de la porte, comme d'ailleurs son châssis lui-même - décoloré par la pluie, grisâtre, et, pour ainsi dire feuilleté, comme de la cendre de cigare, le châssis, lui, à moitié déglingué une des deux chevilles de bois qui tenaient l'angle inférieur presque sortie de son logement, le tout ayant pris du jeu, la traverse inférieure faisant donc avec le montant vertical un angle non pas droit mais légèrement obtus de sorte qu'elle devait racler le sol quand on ouvrait la porte...
(j'ai mis 3 petits points au début et à la fin car je n'ai trouvé ni le début de la phrase (qui devait se trouver sans doute quelques pages avant) ni la fin. Et puis un autre extrait, un brin baroque, où il est question de l'envol d'un cavalier (p149-150) (idem pour les ...)
...je vis Wack qui venait de me dépasser penché sur l'encolure le visage tourné vers moi la bouche ouverte lui aussi essayant sans doute de me crier quelque chose qu'il n'avait pas assez d'air pour faire entendre et tout à coup soulevé de sa selle comme si un crochet une main invisible l'avait attrapé par le col de son manteau et s'élevant lentement c'est à dire à peu près immobile par rapport à (c'est à dire animé à peu près de la même vitesse que) son cheval qui continuait à galoper et moi courant toujours quoi qu'un peu moins vite de sorte queWack son cheval et moi-même formions un groupe d'objets entre lesquels les distances ne se modifiaient que lentement lui se trouvant à présent exactement au-dessus du cheval dont il venait d'être enlevé arraché s'élevant lentement dans les airs les jambes toujours écartées en arc de cercle comme s'il continuait à chevaucher quelque Pégase invisible qui d'une ruade l'eût fait basculer en avant exécutant donc au ralenti et pour ainsi dire sur place...
et p285, on croit rêver, on croit pas, on rêve (et je signale au passage que pour cet extrait comme pour les deux précédents, je respecte scrupuleusement syntaxe et ponctuation -je dis ça parce que ça peut surprendre)
mais comment savoir, comment savoir ? les quatre cavaliers et les cinq chevaux somnambuliques et non pas avançant mais levant et reposant les pieds sur place pratiquement immobiles sur la route, la carte la vaste surface de la terre les prés les bois se déplaçant lentement sous et autour d'eux les positions respectives des haies des bouquets d'arbres des maisons se modifiant insensiblement, les quatre hommes reliés entre eux par un invisible et complexe réseau de forces d'impulsions d'attractions ou de répulsions s'entrecroisant et se combinant pour former pour ainsi dire par leurs résultantes le polygone de sustentation du groupe se déformant lui-même sans cesse du fait des incessantes modifications provoquées par des accidents internes ou externes
lecture du 05.04 au 08.04
note : 4/5
à venir : les gens d'en face, Georges Simenon -
la nausée
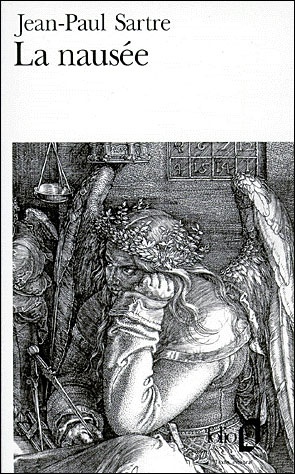 Je ne suis pas trop du genre à arrêter les romans en cours et pourtant là, avec la nausée, je suis bien tenté, tant ce livre me déprime et c'est à tel point que je le juge responsable d'une certaine tristesse qui s'est abattue sur moi depuis quelques jours. A chaque fois que je reprends la lecture, ça m'emmerde de retrouver ce héros désabusé, revenu de tout et qui traîne dans une ville portuaire moche telle une âme en peine. Il passe ses journées dans une bibliothèque à réaliser la biographie d'un type assez banal mort il y a longtemps et le soir, il erre dans les rues, croise des vieilles dames et rentre chez lui où il trouve que son rapport aux objets a changé. Et c'est apparemment l'intrigue du roman. Quelque chose ayant rapport avec la perception du monde est en train de changer en lui.
Je ne suis pas trop du genre à arrêter les romans en cours et pourtant là, avec la nausée, je suis bien tenté, tant ce livre me déprime et c'est à tel point que je le juge responsable d'une certaine tristesse qui s'est abattue sur moi depuis quelques jours. A chaque fois que je reprends la lecture, ça m'emmerde de retrouver ce héros désabusé, revenu de tout et qui traîne dans une ville portuaire moche telle une âme en peine. Il passe ses journées dans une bibliothèque à réaliser la biographie d'un type assez banal mort il y a longtemps et le soir, il erre dans les rues, croise des vieilles dames et rentre chez lui où il trouve que son rapport aux objets a changé. Et c'est apparemment l'intrigue du roman. Quelque chose ayant rapport avec la perception du monde est en train de changer en lui.
Qu'est ce que je vais faire avec un roman comme ça moi ?
Il m'arrive aussi parfois de trouver le nom des objets bizarres. Par exemple, je peux être à côté d'une cabane et puis trouver tout à coup étrange que cette chose en face de moi s'appelle CABANE. Mais combien de fois dans ma vie ai-je prononcé ce mot pour désigner la chose s'en m'en étonner et voici que là, je trouve la sonorité bizarre et je ne trouve pas que CABANE soit le son adéquate pour désigner cette chose où je range mon boui-boui . On m'a toujours dit qu'on devait désigner ça CABANE et ça m'a toujours semblé naturel de le faire, et voici que là, non, ça ne colle plus, c'est pas ça.
Ou bien, ça m'arrive aussi de me retrouver en face d'un visage très connu, que je vois tous les jours et dans ce moment particulier,j'ai l'impression de le regarder pour la première fois et d'en mesurer la singularité. Avant je ne regardais pas ce visage, je le voyais juste, comme le visage de untel point barre. Et puis, plus rarement, ça peut se doubler d'un autre effet : voilà, ce visage connu qui m'était cependant inconnu, et bien est le visage d'un individu qui s'appelle Untel. Je le savais, ça, je l'appelle par ce prénom tous les jours, mais là, à ce moment précis, savoir qu'il s'appelle Untel me surprend.
Ça m'arrive parfois mais ce sont des idées qui me semblent si singulières et si peu exprimables que je n'aurais pas l'idée de les exprimer dans un roman par exemple. Sartre lui le fait. Tant mieux pour lui si ça le soulage de quelque chose. Et puis les philosophes sont peut-être capables de disserter sur des faits anodins pour en donner une portée universelle. Mais je ne vais pas avoir la patience. Au revoir Sartre. Adieu même sans doute. -
CR82 - Courir - Jean Echenoz
 mot de l'éditeur : On a dû insister pour qu’Émile se mette à courir. Mais quand il commence, il ne s’arrête plus. Il ne cesse plus d’accélérer. Voici l’homme qui va courir le plus vite sur la Terre.
mot de l'éditeur : On a dû insister pour qu’Émile se mette à courir. Mais quand il commence, il ne s’arrête plus. Il ne cesse plus d’accélérer. Voici l’homme qui va courir le plus vite sur la Terre.mes avis (deux pour le prix d'un) :
1 - Un petit Echenoz après un grand classique ne peut pas faire de mal. Courir est le dernier roman de l'écrivain qui a donc décidé après Ravel de continuer dans la veine biographique. J'ai lu pas mal de commentaires négatifs de courir qui pour beaucoup est un petit Echenoz et qui n'apporte rien de plus de ce qu'on savait de Zatopek. Ok mais perso, je ne savais rien de Zatopek avant. Donc, j'ai joins l'utile à l'agréable comme on dit avec ce bouquin que j'ai lu en une heure, temps pendant lequel le coureur a pied arrivait à parcourir 20kms. Le style Echenoz est bien toujours là par moment, par petites touches ici ou là mais est peut-être moins marqué que d'habitude au point que j'ai eu souvent le sentiment de lire une simple biographie.
2 - Même si je n'ai pas retrouvé dans ce petit roman (lu en 1heure, c'est à dire durée pendant laquelle Zatopek parcourait 20kms), le style si particulier d'Echenoz, au moins j'ai découvert la vie et les exploits de ce Zatopek, coureur à pied tchécoslovaque hors norme de l'après-guerre. L'auteur rappelle également, et non sans une certaine ironie, les excès du communisme et la récupération par le pouvoir du phénomène Zatopek.
Que dire de plus si ce n'est que c'est une bonne petite biographie sous-titrée quand même "roman" comme pour permettre à l'auteur de prendre quelques libertés dans les anecdotes relatées. On peut dire quand même qu' en dehors d'un travail de recherche (par exemple sur la technique du coureur à pied), Jean Echenoz ne s'est pas beaucoup "foulé" sur ce coup-là.
On l'attend au tournant.
lecture : le 28.03.2009
note : 3/5
à venir : la nausée, Jean-Saul Partre
-
CR80 - la steppe. salle 6. L'Evêque - Anton Tchékhov
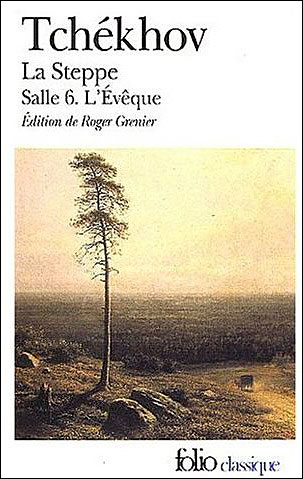 mot de l'éditeur : Les trois nouvelles qui composent ce recueil jalonnent trois étapes décisives de la vie et de l'œuvre d'Anton Tchékhov. La Steppe marque son entrée dans la littérature, Salle 6 sa rupture avec la doctrine tolstoïenne de la non-résistance au mal, L'Évêque l'imminence de la mort. Dans la première nouvelle, l'immensité de la steppe russe est vue à travers le regard d'un enfant qui entreprend un long voyage, sur des chars à bœufs, vers le lointain lycée qui l'attend, vers une vie inconnue. La deuxième a pour triste héros le docteur Raguine qui, après avoir accepté dans l'indifférence la souffrance de ses malades, les mauvais traitements qui leur sont infligés, meurt en disant : « Tout m'est égal. » Quant à l'évêque, dont Tchékhov nous conte les derniers jours, comment ne pas songer à l'auteur lui-même, à bout de forces, encombré de sa gloire, assailli par les importuns, qui voit venir la mort et qui bientôt sera remplacé, oublié...
mot de l'éditeur : Les trois nouvelles qui composent ce recueil jalonnent trois étapes décisives de la vie et de l'œuvre d'Anton Tchékhov. La Steppe marque son entrée dans la littérature, Salle 6 sa rupture avec la doctrine tolstoïenne de la non-résistance au mal, L'Évêque l'imminence de la mort. Dans la première nouvelle, l'immensité de la steppe russe est vue à travers le regard d'un enfant qui entreprend un long voyage, sur des chars à bœufs, vers le lointain lycée qui l'attend, vers une vie inconnue. La deuxième a pour triste héros le docteur Raguine qui, après avoir accepté dans l'indifférence la souffrance de ses malades, les mauvais traitements qui leur sont infligés, meurt en disant : « Tout m'est égal. » Quant à l'évêque, dont Tchékhov nous conte les derniers jours, comment ne pas songer à l'auteur lui-même, à bout de forces, encombré de sa gloire, assailli par les importuns, qui voit venir la mort et qui bientôt sera remplacé, oublié...mot du blogger : 3 nouvelles que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire avec une préférence pour la première, la steppe, où il est question du voyage d'un petit garçon à travers la steppe. Un horizon qui n'en finit pas, le néant à perte de vue et quand même des hommes qui essaient de survivre dans ces espaces dépourvus de reliefs et de quoi que ce soit qui puisse faire rêver.
extrait : "Mais au bout d'un moment, la rosée s'évapora, l'air redevient immobile et la steppe déçue reprit son aspect accablé de juillet. Les herbes baissèrent la tête, la vie s'évanouit. Les collines calcinées par la soleil,brun-vert , mauves au loi, avec leurs teintes mortes comme l'ombre, la plaine et ses lointains vaporeux et le ciel renversé sur elles, terriblement profond et transparent sur une steppe sans forêts et sans montagnes, tout maintenant semblait interminable, engourdi d'ennui."
La nouvelle suivant, Salle 6 est l'histoire d'un médecin dans une bourgade russe, qui s'ennuie et qui se lit d'amitié avec un fou interné dans un asile pourri dont il a la charge. Il se lit tellement avec le fou qu'il finit fou lui-même au point de finir lui aussi à l'asile. J'ai adoré les discussions très métaphysiques entre le médecin et le fou.
J'ai souvent pensé que l'avenir du monde se jouait dans les asiles.
Et l'Eveque, enfin, nouvelle très courte, sur les derniers jours de la vie d'un Eveque. (comme le dit l'éditeur n'est-ce pas, ce à quoi je n'ai rien à ajouter -))lecture du 06.03 au 12.03
note : 4/5
à venir : des souris et des hommes, John Steinbeck