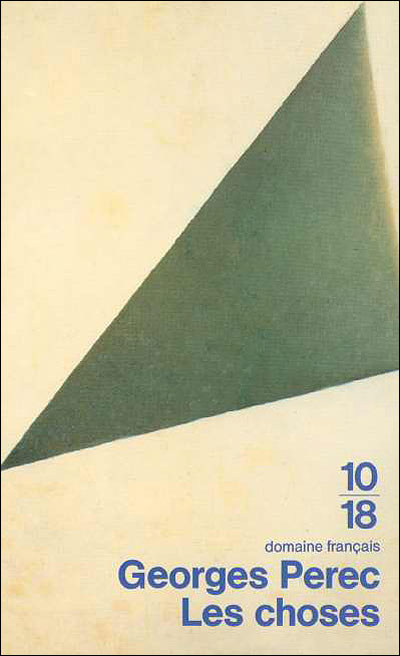 Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, ça c'est un fait, n'est-ce pas... mais c'est aussi passer d'une chose à un autre. C'est en substance ce que veut nous signifier Georges Pérec dans ce petit roman, où il nous montre, en prenant l'exemple de la vie d'un jeune couple de jeunes parisiens moyens, combien il subit la société de consommation ou alors en profite, le tout dépendant en fait de la possibilité qu'il a (ou qu'ils ont individuellement) d'acquérir les choses. Voulant y échapper, les deux "consommateurs" décident d'aller vivre en Tunisie où Sylvie a trouvé une place d'enseignante. Mais là-bas, ils dépriment très vite dans leur grand appartement trop vide ou en se baladant dans la ville déserte..sans vitrines étincelantes. Du coup, retour à Paris...où on reprend les mêmes habitudes, les mêmes rêves et les frustrations qui vont avec.
Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, ça c'est un fait, n'est-ce pas... mais c'est aussi passer d'une chose à un autre. C'est en substance ce que veut nous signifier Georges Pérec dans ce petit roman, où il nous montre, en prenant l'exemple de la vie d'un jeune couple de jeunes parisiens moyens, combien il subit la société de consommation ou alors en profite, le tout dépendant en fait de la possibilité qu'il a (ou qu'ils ont individuellement) d'acquérir les choses. Voulant y échapper, les deux "consommateurs" décident d'aller vivre en Tunisie où Sylvie a trouvé une place d'enseignante. Mais là-bas, ils dépriment très vite dans leur grand appartement trop vide ou en se baladant dans la ville déserte..sans vitrines étincelantes. Du coup, retour à Paris...où on reprend les mêmes habitudes, les mêmes rêves et les frustrations qui vont avec.
J'ai lu les choses lors une nuit d'insomnie après avoir trop bu la veille de Café Grand-mère. Confortablement allongé sur mon matelas Epeda acheté à but et tout en écoutant le dernier album de Françoiz Breut avec mon tout nouveau petit joujou intitulé nokia n95, j'ai consommé goulûment ce produit culturel de code ISBN 2-266-02579-1. Au bout du compte, mon avis concernant ce produit est positif.
extrait :
L'économique, parfois, les dévorait tout entiers. Ils ne cessaient pas d'y penser. Leur vie affective même, dans une large mesure, en dépendait étroitement. Tout donnait à penser que, quand ils étaient un peu riches, quand ils avaient un peu d'avance, leur bonheur commun était indestructible; nulle contrainte ne semblait limiter leur amour. Leur goûts, leur fantaisie, leur invention, leurs appétits se confondaient dans une liberté identique. Mais ces moments étaient privilégiés ; il leur fallait plus souvent lutter : aux premiers signes de déficit, il n'était pas rare qu'ils se dressent l'un contre l'autre. Ils s'affrontaient pour un rien, pour cent francs gaspillés, pour une paire de bas, pour une vaisselle pas faite. Alors, pendant de longues heures, pendant des journées entières, ils ne se parlaient plus. Ils mangeaient l'un en face de l'autre, rapidement, chacun pour soi, sans se regarder. Ils s'asseyaient chacun dans un coin du divan, se tournant à moitié le dos. L'un ou l'autre faisait d'interminables réussites.
moralité : l'argent fait le bonheur.
lecture : nuit du 26 au 27 décembre 08
note : 4/5
commentaire à venir : la mort Venise, Thomas Mann.(re...)
 Le livre d'un homme seul est le récit d'un chinois seul, ...et qui veut le rester malgré l'oppression communiste. Trouvant refuge dans la littérature, il survit tant bien que mal à la révolution culturelle (qui n'a évidemment, comme beaucoup ne le savent pas encore en France de Révolution et de Culturelle que le nom) en se faisant oublier par un opportunisme de bon aloi. Dans cette Chine maoïste où l'on peut mourir pour un geste ou un regard mal placés ou pour avoir parmi ses ancêtres quelque oncle potentiellement droitiste, il vaut mieux se ranger en attendant que ça passe.
Le livre d'un homme seul est le récit d'un chinois seul, ...et qui veut le rester malgré l'oppression communiste. Trouvant refuge dans la littérature, il survit tant bien que mal à la révolution culturelle (qui n'a évidemment, comme beaucoup ne le savent pas encore en France de Révolution et de Culturelle que le nom) en se faisant oublier par un opportunisme de bon aloi. Dans cette Chine maoïste où l'on peut mourir pour un geste ou un regard mal placés ou pour avoir parmi ses ancêtres quelque oncle potentiellement droitiste, il vaut mieux se ranger en attendant que ça passe.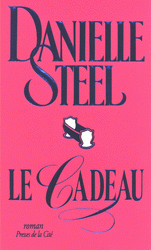 C'est une phrase à géométrie variable. Elle peut traduire au choix l'extrême attention ou la plus grande désinvolture dans le choix d'un cadeau.
C'est une phrase à géométrie variable. Elle peut traduire au choix l'extrême attention ou la plus grande désinvolture dans le choix d'un cadeau.







 "A cet égard, comme on peut l'observer dans les Motel chronicles de Sam Shepard (si traduites en français, à ajouter dans la PAL, ndb), la simple contemplation furtive d'une canette de Coca-Cola broyée ou d'un sac plastique éventré au fond d'un fossé crasseux intéresse plus directement l'homme errant que la traque urbaine du mystère et de l'imprévu. Son état mental est si peu propice au jeu de cache-cache avec le fortuit que seules les grossières évidences de la vie quotidienne contiennent à ses yeux une quelconque significavité. Il faut dire qu'il est déjà pour lui-même un non-sens fortuit. Aussi éprouve-t-il comme un soulagement toute connexion, même minimale, avec ce qui donne l'apparence de lui rappeler quelque chose de connu, fût-ce vulgaire et sordide. L'errant perpétuel est d'une certaine manière le témoin passif de ce qui ne le concerne pas. Dans ces conditions, plus aucune psychogéographie urbaine n'est possible, car, en vérité, la géographie comme le psychisme ont entièrement disparu de cette ville sans espace et sans âme, preuve négative contre Descartes que l'esprit est fonction de l'étendue. Dans ses excursions mécaniques le long des routes qui se greffent sur les autoroutes périphériques et où pullulent motels, stations-service, magasins d'usines, concessionnaires de voitures, hangars et restauroutes, le nomade ne se sent absolument pas l'âme d'un chercheur. Quêtes et traques, périples et filatures ne constituent pas ses passe-temps favoris. A dire vrai, il ne convoite absolument rien ni personne ; il ne se sent investi d'aucun message, d'aucune charge ; mais il s'attache simplement à entrer en contact avec ce peu de réalité qu'il espère ou devine juste derrière son pare-brise. Tant bien que mal, il s'efforce de retrouver son chemin, si chemin il y a. Tel Oedipe à Colonne, "possédant toutes les routes, il n'en possède aucune". Du reste, l'errant n'a plus affaire à la rue où la masse se concentre, mais à la route où la somme des individus se disperse. Dans cet espace urbain qui ne lui évoque rien, il vaque à son unique occupation : transiter."
"A cet égard, comme on peut l'observer dans les Motel chronicles de Sam Shepard (si traduites en français, à ajouter dans la PAL, ndb), la simple contemplation furtive d'une canette de Coca-Cola broyée ou d'un sac plastique éventré au fond d'un fossé crasseux intéresse plus directement l'homme errant que la traque urbaine du mystère et de l'imprévu. Son état mental est si peu propice au jeu de cache-cache avec le fortuit que seules les grossières évidences de la vie quotidienne contiennent à ses yeux une quelconque significavité. Il faut dire qu'il est déjà pour lui-même un non-sens fortuit. Aussi éprouve-t-il comme un soulagement toute connexion, même minimale, avec ce qui donne l'apparence de lui rappeler quelque chose de connu, fût-ce vulgaire et sordide. L'errant perpétuel est d'une certaine manière le témoin passif de ce qui ne le concerne pas. Dans ces conditions, plus aucune psychogéographie urbaine n'est possible, car, en vérité, la géographie comme le psychisme ont entièrement disparu de cette ville sans espace et sans âme, preuve négative contre Descartes que l'esprit est fonction de l'étendue. Dans ses excursions mécaniques le long des routes qui se greffent sur les autoroutes périphériques et où pullulent motels, stations-service, magasins d'usines, concessionnaires de voitures, hangars et restauroutes, le nomade ne se sent absolument pas l'âme d'un chercheur. Quêtes et traques, périples et filatures ne constituent pas ses passe-temps favoris. A dire vrai, il ne convoite absolument rien ni personne ; il ne se sent investi d'aucun message, d'aucune charge ; mais il s'attache simplement à entrer en contact avec ce peu de réalité qu'il espère ou devine juste derrière son pare-brise. Tant bien que mal, il s'efforce de retrouver son chemin, si chemin il y a. Tel Oedipe à Colonne, "possédant toutes les routes, il n'en possède aucune". Du reste, l'errant n'a plus affaire à la rue où la masse se concentre, mais à la route où la somme des individus se disperse. Dans cet espace urbain qui ne lui évoque rien, il vaque à son unique occupation : transiter."
